La Fabrique
- Par Gilles Cervera
- 18 avr. 2017
- 7 min de lecture

Photographie : © Gérard Fourel
C’est là-bas, derrière le talus. Le talus n’est pas haut. Figurez-vous une vague bosse, ou plutôt une vague qui bossue à peine le paysage.
La plaine est autour, champagne immense qui s’étend à perte de vue. A perte de vue, figurez-vous le, il n’y a rien. Pas un obstacle, pas un muret ni la moindre cabane. Un arbre, peut-être, un saule un peu plié qui résiste à tant de plaine, à tellement d’horizon que cet arbre-là, voyez-vous, pourrait être signalé sur une carte. Il mériterait d’être couché quelque part sur un registre des arbres qui résistent, et à l’inventaire de la résistance des arbres, celui-ci pourrait figurer en bonne place, oui, ces quelques branches, ces rameaux tordus, cet arbuste quasi fantomatique mais qui est là. Honneur de cet arbre, voyez-vous.
Mais à cette distance, force nous est de constater que nous ne sommes pas certains que cet arbre soit un arbre. Nous verrons, nous nous approcherons, car il est si loin. Nous prendrons le temps. Car nous avons du temps. Dans ce paysage, le temps est long aussi, distendu, semblant immense. C’est pour cela aussi, que ces coups réguliers qui viennent de derrière cette bosse sont pour nous, évidemment, plus qu’un appel, un soulagement.
Oui, il y a cette bosse, n’est-ce pas. Le champ à cet endroit semble monter un peu et de suite redescendre, c’est que dans ces campagnes, il y a loin, vous en souvenez-vous, des gens de la terre vivaient dans la terre. Il y avait ici, vous vous en rappelez peut-être, des mondes souterrains, des vies de rats. Dans les caves et les grottes, les galeries sous la terre, il y avait des gens. Oui, des gens. Dans le cœur des champs, sous l’épaisseur de la glèbe, dans des fosses plus ou moins profondes, les familles étaient logées. Oui, c’est cela. Il s’agissait de logements. Alors il se peut que cette bosse, soit un reste de ces troglodytes. Vous savez, contre le froid hivernal, car ici il peut faire très froid, vous savez, la terre conserve une température constante. C’est rare qu’il gèle à un mètre sous la surface. La surface, par contre, peut être durcie par le gel, les labours peuvent briller comme du verre, mais sous leur épiderme, le germe conserve une chaleur suffisante, vous savez.
Les hommes donc sous tant d’horizon immense résolvaient ainsi cette histoire des grands froids. Et puis, n’est-ce pas, la chaleur de l’été est assez terrible aussi. Accablante parfois. Alors, vous savez, tout le jour, ces gens restaient dans leurs grottes, ils demeuraient dans cette terre suffisamment fraîche, et l’été se passait en dépit de ses feux si terribles. A midi, la plaine s’immobilisait, la lumière verticale ne plantait ses rayons qu’à quelques centimètres sous la surface. Les gens pouvaient sommeiller, la terre tempère. La nuit cependant, les gens sortaient de leurs trous, pour faire leurs besoins, pour trottiner aussi, faire fonctionner les organismes. Ils formaient le long des champs des sortes de colonnes assez sombres. Les nuits de pleine lune, vous auriez dit des processions de fantômes, ces hommes et ces femmes qui reprenaient le mouvement, dansaient près des animaux des sortes de danses pataudes, des chants de gorge étaient comme déglutis, vous savez, les loups devaient fuir ces plaines, car les hommes pouvaient littéralement leur ressembler.
Vous savez, ces hommes qui avaient néanmoins recours au feu pouvaient éclater de rires étonnants. Forcément, ils fréquentaient davantage les hiboux et les chouettes que les merles ou les cigognes. Les cigognes évidemment, ces hommes ne les envisageaient même pas. Ni arbre ni clocher, ni silo en relief ni tour de guet, pour y arrimer un nid et revenir d’une saison l’autre. La seule chose qui dépassait parfois, c’étaient de maigres tuyaux, des cheminées. C’est par là que certains soirs, quand la lumière décline l’hiver, le filet des fumées s’enroulaient, c’est pratiquement le seul moment où s’alliait quelque chose entre ces grottes, entre la vie des habitants de ces grottes. Ces gens voyez-vous étaient des gens de la terre, vous savez, comme on dit des gens de terrier, des terriens au sens plein du terme. Au printemps, ils sortaient, cultivaient, semaient. Des pois, des céréales, quelques coquelicots leur donnaient l’idée du rouge. Mais vous voyez bien que ces coquelicots étaient pour eux une surprise, l’idée du rouge venait de ces pétales, c’était leur surprise. Car, ces graines avaient voyagé, elles avaient germé là sans qu’ils interviennent. Voilà, c’était ainsi que le bleu du ciel était pour eux une couleur à part dans le dictionnaire, bleu se disait printemps, le rouge, fleur venue d’on ne sait où et il était consacré pour les gris et les marrons, dans leur dictionnaire, de nombreuses pages. Car les terres sont grises la nuit, marrons tout le temps, leurs peaux avaient cette couleur, ces camaïeux gris et marrons, bruns pour certains visages, noirs de Sienne pour d’autres, les couleurs étaient à ce point réduites aux couleurs de la terre, voyez-vous, qu’en réalité, marron se disait visage, œil, gris de terre et le reste, les nuances, étaient désignées par le nom du corps. Ventre, c’était pâle, chaud, c’était sein, fesse bien sûr, c’était pour le noir. Le sexe lui-même n’était ni coloré ni envisagé. L’ignorance paraissait totale en ce qui concerne ce mot comme sur beaucoup d’autres.
D’ailleurs, voyez-vous, nous parlions peu avant de lexique, d’index voire de dictionnaire, bien entendu il n’en était rien. Ces gens parlaient peu, n’écrivaient pas.
La terre dictait le vocabulaire, les couleurs nous l’avons dit, la douleur quant à elle résidait essentiellement dans le non dit. A tel point que nous nous sommes demandés, voyez vous, ce qu’il fallait entendre de leur propre désignation. Comment s’appelaient-ils les uns les autres. S’appelaient-ils ? Leur communauté était-elle désignée par un seul mot, eux-mêmes, individuellement, nous avons la quasi certitude qu’ils ne se nommaient ni ne se prénommaient. Nous n’en sommes évidemment pas sûrs.
Vous savez, ils passaient le plus clair de leur temps dans les galeries. Si un enfant venait à naître et qu’il ne mourait pas, alors, ils creusaient un peu plus loin, ils descendaient un peu plus profond, c’est ainsi que les vagues collines qui bossellent la plaine sont des anciens villages.
C’est ainsi que nous n’avons jamais l’assurance que ces gens de la terre entre eux se parlaient. Vous savez, ce sont souvent des bouches sans dent que l’odeur de terre empreinte. Il est possible que ces gens n’avaient pas recours à des gestes autres que vitaux : chier, pisser, ronger, dormir. Semer en effet pouvait aussi venir, mais c’était exceptionnel et cela ressortait d’une spécialisation. La grotte du semeur souvent était un peu dégagée des autres galeries. Il allait chercher assez loin chercher des semences, il allait jusqu’au bout des plaines. Sans doute n’est-ce pas, parlaient-ils si peu puisque cela ne leur apparaissait ni vital ni indispensable et voyez-vous, ils n’avaient pas eu besoin de penser à ouvrir des chemins. La plaine était si vaste, en quelque sorte suffisante. L’exploration du lopin, oui c’est cela, leur suffisait.
Mais nous revenons à ce talus qui fait à peine un obstacle aux vents. C’est depuis ce talus qu’un bruit sec retentit. A intervalle régulier.
C’est contre ce talus, à cause du petit obstacle qu’il doit présenter aux vents du nord, que des objets roulent, que des branches d’épines s’amoncellent, ou des boîtes de conserve ou d’autres capots de voiture, des milliers de choses arrivent jusqu’à cette bordure, s’amassent, s’entassent et c’est au milieu de cela, qu’il est assis.
C’est là qu’il a fondé la fabrique.
Il est assis à même le sol. Son vêtement a dû être un bleu de mécanicien ou de forgeron. D’ailleurs il est un peu les deux. Car parfois il allume entre ses cuisses largement ouvertes un petit feu. Sur ce brasier, il fait fondre les métaux, il chauffe à blanc des couvercles, des enjoliveurs de roue, il déchire les métaux, fabrique des clous, agrafe entre eux des pièces, c’est une sorte d’usine, oui, il usine le monde, il enlève l’écorce des branches, met à nu l’aubier, il lime, râpe, il démanche, emboîte, il délasse des fils, sépare des étoffes, souvent voyez-vous des sacs de semence en jute ou des blocs de laine que les bêtes abandonnent, il recommence mille fois, polit, repolit, parfois d’un couvercle, il recompose un chaudron, il reforme un monde, dessinant des roues avec les rondins, faisant des essieux et des vérins, il reforme et décompose, nous l’avons vu, n’est-ce pas, d’un caillou terriblement déformé construire une sorte d’envasement aux fonctions apparemment inconnues. Il entasse des brindilles, les range, les ordonne, cette collection ne vise pour l’instant à rien de précis, si nous l’interrogeons, nous ne sommes sûrs d’aucune réponse. La seule commande à laquelle il répond dépend évidemment de lui, d’une volonté à lui même inconnue. Derrière ce talus, les jambes ouvertes, ses gestes sont précis. S’il pleut, il arrête la fabrique. Tout reste sous la pluie. Il peut pleuvoir pendant des jours, c’est l’automne ou le printemps. Les rivières gonflent mais nous sommes loin du premier fleuve. Pas un canal ne traverse la plaine. Sans doute sommes-nous trop loin, sans doute ces plaines semblent un peu ingrates. Durant ces si longues périodes de pluie, les métaux rouillent, les bois se fendent, les charnières se raidissent. Il reprend l’ouvrage, la fabrique ouvre, dès qu’évidemment un rayon de soleil réchauffe les terres. L’endroit où il est assis est arrondi, creusé, il est possible qu’un jour, il disparaisse, enseveli par ces monceaux de filetage, ces tas d’écrous dépareillés, car la collection ne répond, voyez-vous à aucune hiérarchie, ni de taille, ni de fonction, ni d’intérêt.
La fabrique n’est pas abritée. Il la dirige en plein nord. L’hiver, voyez-vous, ses mains sont bleues, nettement plus bleues que les manches de sa veste. Si nous lui adressons la parole, il est nécessaire d’utiliser des mots rapides, plutôt des souffles. Il ne répond évidemment pas. Ou alors, il jette une pièce en cours d’usinage assez loin de lui. Ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas d’une quelconque attaque, c’est une manière de répondre, forte, intransigeante, c’est n’est-ce pas, dans un registre de phrases en cours de réalisation, et ce qui les réalise ce sont les morceaux de bois, les bris de verre, les métaux polis et repolis. Ses gestes composent une sorte de dictionnaire et les objets, un jour, devront s’assembler. Notre inquiétude est qu’un jour, nous nous demandons s’il ne s’étouffera pas sous le sable.
La terre autour de lui forme une petite plage, voyez-vous. Il s’y enfonce. Car le poids des objets usinés est de plus en plus conséquent. La fabrique sera alors fermée. Il n’y aura plus de bruit. Nous pourrons aller plus loin, nous approcher de cet arbre. Ou prétendu.
Il n’est pas sûr que c’en soit un. La preuve, n’est-ce pas, c’est que les oiseaux font des nids dans la fabrique. Un jour, en grattant tout près de lui, il voulait redresser une sorte de petit arc biscornu en métal. Il a trouvé trois œufs. Il ne les a pas gobés.

Photographie : © Gérard Fourel
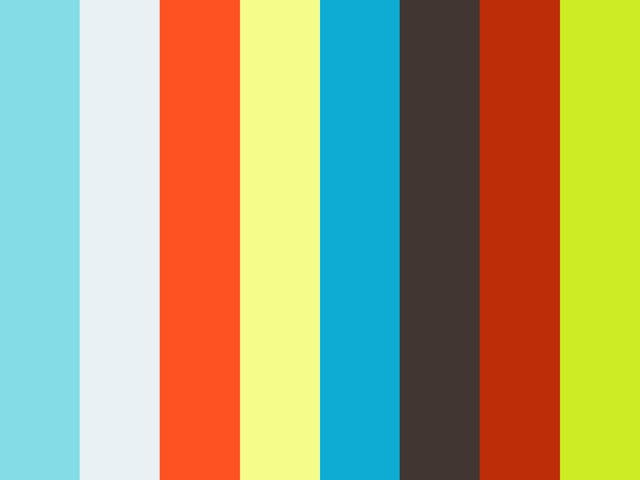



















Commentaires